Pierre Deval voit le jour en 1897 à Lyon, dernier né d’une famille de soyeux dont les relations commerciales s’étendent à travers le monde. Tout jeune, il dessine en autodidacte et installe son premier atelier à proximité de la maison familiale. Il se frotte tout d’abord à la copie des anciens et le musée des moulages devient plus particulièrement son terrain d’apprentissage.
Fasciné par Rodin, Deval est touché par la pureté des lignes et la puissance expressive du dessin du maître, ainsi que par la sensualité de ses corps.
La musique, la littérature et la poésie nourrissent son jeune esprit de peintre. Il peint avec passion et pourtant, dans une lenteur appliquée.
Mobilisé pendant la guerre, Deval, qui souffre de problèmes pulmonaires depuis son enfance, est finalement renvoyé chez lui où il passe le reste du conflit.
En 1921, il se rend à Paris pour parfaire sa formation. Après un rapide passage dans l’atelier Cormon, il s’inscrit à l’Académie de la Grande Chaumière, où il suit les cours d’Émile-René Ménard et de Lucien Simon.
Grâce à son ami Jacques Rigaut, il fait la connaissance de Tristan Tzara, figure de proue du dadaïsme. En ce début des années 1920, il fonde avec Jean Lacroix et Jean Epstein la revue Promenoir. Bien qu’éphémère — six numéros seulement — la revue attire l’attention de figures majeures qui y collaborent : Cendrars, Cocteau, Soupault, Léger, Ozenfant… un ancrage dans le monde de l’avant-garde. Deval, fidèle à ses racines lyonnaises, organise dans sa ville natale une exposition intitulée “Cubisme, Purisme, Expressionnisme”, permettant aux Lyonnais de découvrir la peinture d’avant-garde dans toute sa diversité.
Bien que vivement intéressé par la modernité, la rapidité de mouvement qui caractérise son époque, Deval fait le choix d’embrasser la représentation classique : il conservera ainsi une utilisation traditionnelle de la ligne, de la composition. En ce sens, il se range parmi les partisans du rappel à l’ordre, ce courant qui, au sortir de la guerre, appelle à un retour aux racines de la tradition picturale.
Deval entame la réalisation de panneaux décoratifs, de portraits, qui témoignent de l’importance et de la survivance des leçons de ses devanciers, non sans payer un tribut à une forme de modernité.
Son premier envoi au Salon, Ariane, est distingué par le Prix Jean-Julien Lemordant. Le critique Léonce Bénédite souhaite en faire l’acquisition pour le Musée du Luxembourg dont il est conservateur. Grâce à cette oeuvre, Deval remporte aussi une bourse de séjour à la Villa Abd-el-Tif. À l’automne 1922, Deval s’embarque pour un séjour de deux ans en Algérie.
Précédents lauréats de cette bourse de voyage, Jean Bouchaud et Maurice Bouviolle vont cohabiter au sein de cette Villa Médicis à la mode orientale avec le sculpteur Ludovic Pineau et Pierre Deval, les nouveaux pensionnaires.
Le peintre explore avec intérêt jusqu’au Sud du pays, gagne même le Maroc le temps d’un séjour. En Algérie, Deval prend peu à peu ses distances avec l’esprit traditionnel et plutôt colonialiste de la Villa Abd-el-Tif, incarné par Léonce Bénédite. Il ne participe pas systématiquement aux manifestations organisées dans ce cadre et sa production n’est pas vraiment ancrée dans la veine habituelle de celle des résidents. Son tableau La Plage, présenté en 1924, choque particulièrement les algérois par sa crudité. L’artiste n’est pourtant pas un provocateur, il a simplement exprimé une modernité inédite sur place, bien que tout à fait modérée de l’avis d’un milieu parisien davantage habitué, bien-sûr, à la diversité des manifestations artistiques.
Deval fait la connaissance d’Albert Marquet, son ainé de 22 ans et malgré cette importante différence d’âge, une amitié durable se noue entre les deux artistes.
Le jeune peintre a épousé sa fiancée Henriette, qui l’avait suivi dans son séjour algérien et de retour en France, le couple investit à Paris, quai Saint Michel, dans le même immeuble que les Marquet et Jacqueline Marval, un appartement anciennement occupé par Matisse.
Les couples Marquet et Deval sont inséparables. À l’été 1925, Marquet invite ses amis en Norvège où une grande maison lui a été prêtée par un collectionneur. D’autres séjours en commun suivront à Marseille, Porquerolles… Deval rencontre à ses côtés les anciens Fauves : Camoin, Manguin, Jean Puy, Matisse.
Au printemps 1925, les Deval dénichent le domaine d’Orvès : à La Valette-du-Var, une propriété du XVIIIème siècle, presque à l’abandon, pour laquelle ils ont un véritable coup de foudre. Ils s’y installent immédiatement.
Le romancier Henri Bosco est l’un des visiteurs du lieu, charmé par l’atmosphère unique de cette maison de maître historique, du jardin abondamment arboré et arrosé par des sources, surmonté d’une pinède et parcouru de bassins où nagent des poissons.
En 1927, Deval accompagne Bosco en Grèce, sur les traces des grands mythes classiques qui tous deux les fascinent.
Deval trouve dans sa retraite varoise un environnement favorable à la création mais il n’est pourtant pas absent des sphères artistiques lyonnaise et parisienne : assurant une présence aux Salons officiels, il expose également en galerie : chez Carmine en 1927, chez Druet en 1929…
Le plus clair de sa production est consacré à la représentation féminine. Les modèles se succèdent au domaine et en fonction de l’archétype incarné, chacune inspire un univers de sensualité.
Le collectionneur et critique Georges Besson, l’ayant pris en amitié, le tient au courant des actualités artistiques qui se succèdent à la capitale en son absence.
Au début de l’année 1930, le décès de son frère Jean, qui avait pris en charge les soieries familiales et leur réseau international, est une double peine : l’entreprise est ruinée. Deval parvient à conserver, tant bien que mal, le domaine d’Orvès mais il va devoir trouver le moyen de subvenir à ses besoins sans le soutien familial qui l’a toujours rassuré.
L’artiste, aidé par George Besson, tisse un réseau de galerie dans lesquelles il montre son travail dans ces années d’avant-guerre et de crise, travaillant avec acharnement.
Le recours aux portraits de commande, qu’il considère comme étant purement alimentaire au sein de sa production, va lui permettre d’entretenir son domaine d’Orvès et de subvenir aux besoins de sa famille. L’écrivain Pierre-Jean Jouve et sa femme, l’une des premières psychanalystes, séjournent tout un été chez les Deval, introduits par les amis communs Willy Eisenchitz et Claire Bertrand. C’est que le charme d’Orvès agit profondément sur les créateurs, les artistes.
La vie familiale se poursuit loin du tumulte parisien pour le couple qui élève deux enfants, Philippe et Françoise.
L’occupation oblige bientôt à la cohabitation avec l’ennemi, au sein même du domaine. Orvès sert à loger les officiers allemands. En 1944, les Deval sont finalement sommés de quitter la maison et s’installent dans une ferme voisine puis au pied du Ventoux. La propriété est mise à mal, un millier d’arbres est coupé.
À la Libération, la famille reprend possession du domaine et un travail de longue haleine les occupera, durant plusieurs années, à la restauration du bâtiment et de ses jardins.
En 1951, une brouille le sépare définitivement de George Besson, son ami de longue date, privant l’artiste de l’influence du critique parisien.
Deval reprend cependant ses expositions régulières dans les galeries de Toulon, Lyon, Genève, Mulhouse, Aix-en-Provence… En 1971, le musée des beaux-arts de Toulon lui consacre une rétrospective. Presque centenaire, l’artiste s’éteint à l’ombre des oliviers d’Orvès.
D’après Deval, le Maître d’Orvès par Michèle Gorenc, Editions Autres Temps, 1997.

DEVAL en son domaine
8 mai 2025 - 11 mai 2025
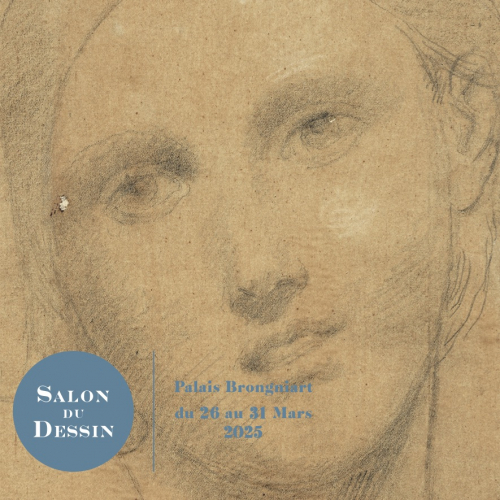
Salon du Dessin 2025
26 mars 2025 - 31 mars 2025


